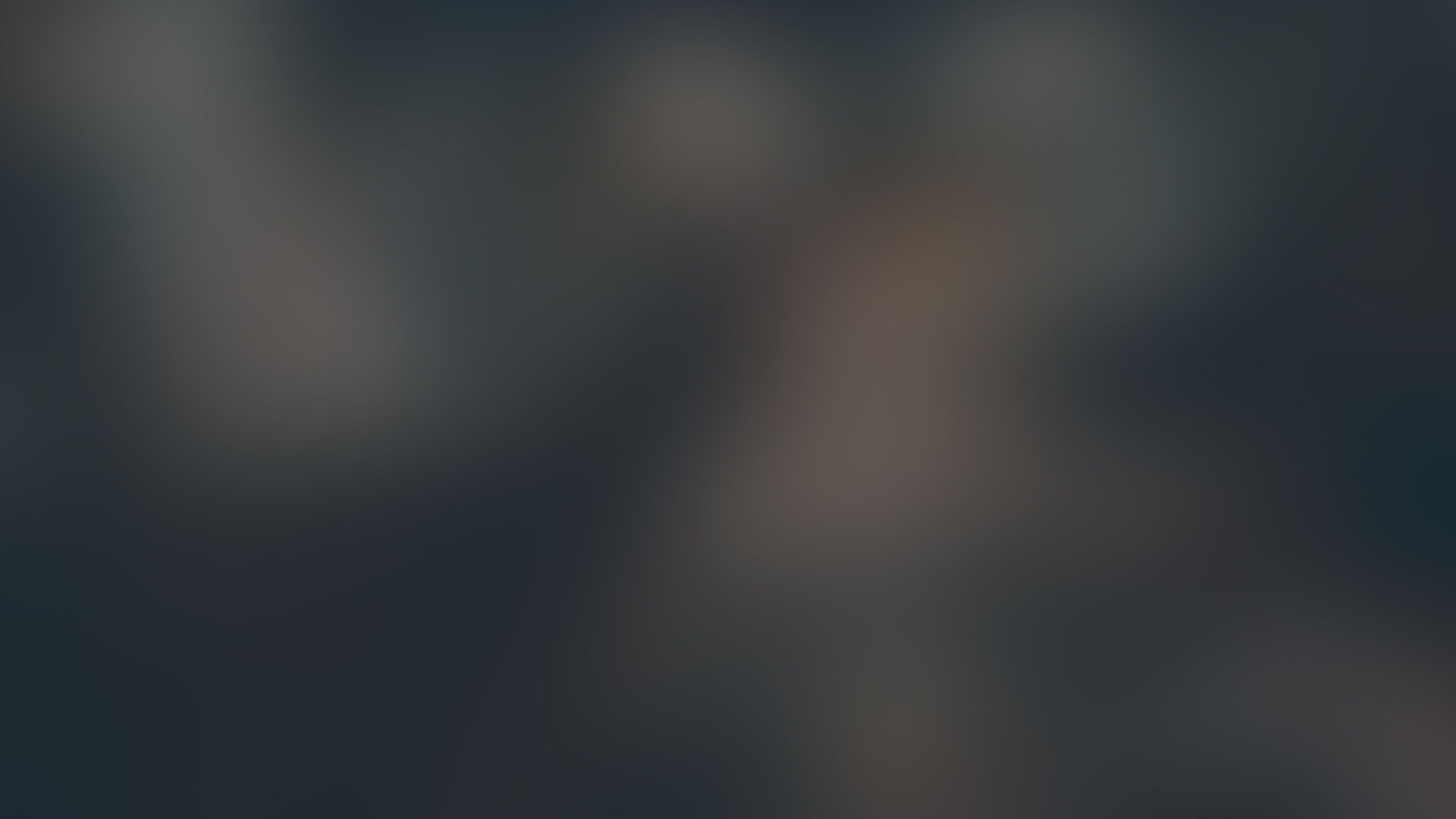
Le coin théorique des scientifiques
REGLEMENTATION RELATIVE AUX DEBITS MINI DE VENTILATION
Les débits mini réglementaires de ventilation (en m3/h) sont fixés par l'arrêté du 24 mars 1982 et dépendent du nombre de pièces principales du logement :


On voit que les systèmes hygroréglables permettent de réduire les débits de ventilation. Les débits mini réglementaires indiquent la tendance mais ne présument pas des débits réels futures, car en hygro, bouches et entrées d'air (hygro B) s'ouvriront dès que les taux d'humidité augmenteront.
ENVELOPPES THEORIQUES DES BOUCHES ET ENTREES D'AIR
Pour les systèmes Hygro A (débits d'extraction des bouches modulés en fonction de l'hyrométrie relative de la pièce) et pour les systèmes Hygro B (débits d'extraction des bouches et des entrées d'air modulés en fonction de l'hyrométrie relative de la pièces), les volets mobiles des bouches ou des entrée d'air s'ouvrent -hygro haute) ou se ferment (hygro basse) selon les exemple ci-dessous.
Les débits mini ou maxi ainsi que les plages de modulation dépendent de la configuration du logement. Ainsi, pour le choix et la pose de tels systèmes, il convient de consulter et de respecter les tableaux fournis par les fabriquants et qui définissent précisément, pièce par pièce, les référence de chaque bouche ou entrée d'air à poser.

CALCUL DES GAINS ENERGETIQUES D'UN DOUBLE FLUX
Pour calculer les gains énergétiques apportés par un double flux, on utilise couramment la formule :
W (puissance de chauffe) = 0.34 Q (débit en m3/h) DT°(variation de température).
En effet, 1m3 d'air pèse environ 1,3Kg et 1 KG d'air nécessite environ 1000 joules pour chauffer de 1°C donc la puissance pour chauffer 1m3 de 1°C en 1 heure = (1.3 Kg x 1000 joules) / 3600 secondes = 0.34W si on prend les valeurs exactes.
Pour reprendre notre exemple hivernal, 0°C extérieur, 20°C intérieur et 150m3/h de ventilation d'un logement T5, pour compenser les pertes liées à la ventilation du bâtiment, il faut chauffer chaque heure 150m3 d'air extérieur à 0°C pour les porter à 20°C. Ceci nécessite donc une puissance de chauffe de 0.34 x 150m3/h x 20°C = 1020 watts. Un double flux haut rendement (90% annoncé et 80% restitué) permettra d'économiser ce jour 1020 x 80% = 816W pendant toute la journée (soit environ l'équivalent d'un aspirateur qui tournerait toute le journée). Ceci correspond à une économie journalière de plus de 4€ sur la facture d'électricité.
CALCUL DE LA PUISSANCE DE CHAUFFAGE NECESSAIRE
Plusieurs méthodes plus ou moins complexes permettent d'évaluer la puissance de chauffage à installer dans un logement.
Historiquement, il y a une vingtaine d'année, on utilisait couramment le ratio de 100W par m² à chauffer. Ce ratio n'est pas extrêment précis mais permet néanmoins d'approcher pièce par pièce les besoins en chauffage. Néanmoins, au cours de ces 20 dernières années, les performances énergétiques des bâtiments se sont beaucoup améliorées. Aussi, avant d'utiliser ce ratio, il convient d'estimer le niveau d'isolation et d'étanchéïté du logement afin de moduler ce ratio vers des valeurs plus basses pour les bâtiment plus récents.
Parmis les méthodes plus fines (mais aussi plus complexes), des méthodes de calcul par coefficient G sont appliquées. Le Coefficient G est l'indice global de déperdition d'une habitation exprimé en Watt / (m3 x °C). La puissance nécessaire pour chauffer le logement est donnée par la formule :
W (puissance de chauffe nécessaire) = G x V (volume en m3) x (T°consigne - T°base).
La température de base est la T° extérieure la plus basse (raisonnablement probable) à laquelle le logement doit pouvoir faire face. Cette T° dépend donc de la région, de l'altitude et de la proximité ou non avec la mer ou un lac important.
Ci dessous, la carte donne les valeurs de la température de base à appliquer en fonction de la localisation du logement et de son altitude.
Précisons que pour tenir compte de l'effet "tempéré" de la mer ou d'un lac conséquent, tout logement situé à moins de 25Km de la mer ou d'un lac conséquent se voient ajouter 2°C à la température de base indiquée dans le tableau ci-dessous.
Carte selon source ABCClim.net d'après la norme française NF EN 12831-1

G dépend quant à lui au niveau d'isolation du logement. On utilise couramment les valeurs suivantes :
- G = 0,20 pour un niveau d'isolation compatible avec la RT 2020
- G = 0,60 pour un niveau d'isolation compatible avec la RT 2012
- G = 0,80 pour un niveau d'isolation compatible avec la RT 2005
Pour les logements antérieurs à la RT2005, les résultats prédéfinis par Qualit'ENR permettent d'évaluer G en fonction des coefficients K plancher bas, K murs et K toiture
K plancher bas = 1.5 pour plancher bas sur vide sanitaire non isolé
= 1 pour plancher bas sur terre plein non isolé
= 0.5 pour plancher bas sur terre plein isolé ou sur vide sanitaire isolé.
K murs = 3 pour des murs en granite ou basalte 40 cm, ou béton plein 22cm
= 2 pour pierre semi ferme 40cm, pour pierre tendre 30cm, pour brique pleine 35cm, pour aglo béton parois épaisse 30cm, pour torchis terre comprimée 30cm, pour brique creuse 25cm ou pour parois double avec vide d'air 35cm
= 1 pour mur en béton cellulaire
= 0.5 pour mur avec parois isolée
K toiture = 3 pour combles non chauffées et fortement ventilées et plancher non isolé, ou pour toiture terrasse isolée
= 1.5 pour combles non chauffées fortement ventilées avec plancher isolé ou combles non chauffées faiblement ventilées avec plancher non isolé
= 0.5 pour combles chauffées et toiture isolée, ou pour toiture terrasse isolée, ou pour combles non chauffées faiblement ventilées et plancher isolé.

Exemple :
Pour une maison de 80m² au sol de 2 étages (volume = 80m² x 2.7m x 2 étages = 432m3) situé à Saint Nazaire (zone B situé entre 0 et 200m d'altitude, en bordure de mer à moins de 25Km de la mer), température de base = -4°C + 2°C = -2°C.
Maison de 1980 avec murs isolés (Kmurs = 0.5), plancher bas sur terre plein non isolé (K plancher bas = 1) et combles non chauffées fortement ventilées avec plancher isolé (K toiture = 1.5). D'après les tableaux Qualit'ENR, on lit G = 1.05
La puissance nécessaire pour chauffer ce logement sera donc
W (puissance de chauffe nécessaire) = G x V (volume en m3) x (T°consigne - T°base).
W = 1.05 x 432m3 x (19°C + 2°C) = 9 526 W
Historique des Réglementations Thermique en FRANCE
Les divers Réglementation Thermiques (RT) se sont succédées en France pour limiter les consommations maximales des bâtiments neufs. Les RT prennent en compte :
- Les besoins en thermique (chauffage, climatisation et ventilation),
- Les besoins en Eau Chaude Sanitaire (ECS),
- Et les besoins en éclairage.
RT 1974 (01/05/1974 --> 1988)
À la suite du premier choc pétrolier de 1973, le premier ministre Pierre Messmer instaure la première réglementation thermique RT 1974 en France en 1974.
Alors que les bâtiments construits suivant les normes en vigueur entre les années 1950 et 1973 étaient estimés à 300 kWh/(m2 .an), l'objectif de la RT 1974 est une réduction de la consommation énergétique de 25 % pour atteindre 225 kWh/(m2 .an).
Notons que l'utilisation généralisée du coefficient G des « déperditions thermiques » par les parois du bâtiment provient de cette RT 1974. Ce coefficient est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius (W/(m3 .°C)) et nous sert encore pour évaluer les puissance thermiques nécessaires (voir chapitres précédents).
RT 1982
Associée à la première Réglementation Thermique de 1974 comme une évolution de cette dernière, la RT 1982 est appliquée en 1982 suite au deuxième choc pétrolier de 1979. La RT 1982 rend la ventilation des bâtiments permanente et renforce les exigences d'isolation afin d'atteindre une réduction supplémentaire des consommations énergétiques des logements de 20 % (170 kWh/(m2 .an)) par rapport aux consommations relatives à la RT 1974 (225 kWh/(m2 .an)).
RT 1988 (1988 --> 01/06/2001)
La deuxième réglementation thermique date de 1988. Elle s'applique aux bâtiments neufs résidentiels et non-résidentiels. L'objectif de cette RT est la réduction des consommations énergétiques pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage pour les logements neufs. L'introduction du coefficient C répond à la recherche de l'optimum économique.
RT2000 (01/06/2001--> 01/09/2006)
La troisième réglementation thermique, dont l'arrêté d'application date du 29 novembre 2000, s'applique aux bâtiments neufs résidentiels et tertaires. En résidentiel, l'objectif est de réduire les consommations maximales de 20 % par rapport à la RT 1988 afin de ne pas dépasser 130 kWh/(m2 .an).
RT 2005 (01/09/2006 --> 01/01/2013)
La quatrième Réglementation Thermique date du 2 septembre 2006. Par rapport à la RT 2000, elle demande une amélioration de 15 % de la performance thermique afin de ne pas dépasser 90 kWh/(m2 .an). Cette RT 2005 s'applique aux bâtiments neufs et aux parties nouvelles.
Dans le but de comparer des installations utilisant des sources d'énergie différentes (gaz et électricité par exemple), la consommation dans la réglementation thermique française s'exprime désormais en énergie primaire qui est égale à l'énergie finale délivrée ajoutée à toutes les pertes d'énergie durant le processus d'extraction, de production et de transport. Ce nouveau principe établi sous la pression des différents lobbings de fournisseurs d'énergie pénalise lourdement le chauffage électrique au profit du gaz et du fioul. Les conséquences à venir en termes de rejet CO2 obligeront un revirement spectaculaire de position dans le début des années 2020 ,ceci afin de recoller avec les engagements en terme de rejet de CO2.
Avec la RT 2005, de nouveaux labels apparaissent pour pousser des niveaux de performance énergétiques supérieurs aux critères RT2005 :
-
HPE (haute performance énergétique) 2005, consommation maximale réduite de 10 % ;
-
HPE EnR (HPE - énergie renouvelable) 2005, consommation maximale réduite de 10 %, avec utilisation d'énergie renouvelable ;
-
THPE (très haute performance énergétique) 2005, consommation maximale réduite de 20 % ;
-
THPE EnR 2005, consommation maximale réduite de 30 %, avec utilisation d'énergie renouvelable ;
-
BBC (bâtiment basse consommation) 2005, consommation maximale à 50 kWhep/(m2.an) (à peu près -50 %).
-
En 2009, sont apparus deux nouveaux labels applicables à la rénovation.
-
HPE rénovation 2009, consommation maximale à 150 kWhep/(m2.an),
-
BBC rénovation 2009, consommation maximale à 80 kWhep/(m2.an).
Dans la pratique, le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) édite des règles de calcul standard ainsi qu'un moteur de calcul informatique pour évaluer le niveau de performance énergétique d'un bâtiment. Les éditeurs de logiciels ou les bureaux d'études thermiques sont tenus de respecter ces règles et réalisent leurs propres interfaces d'utilisation pour lesquelles ils doivent recevoir un agrément du CSTB pour commercialiser ou utiliser leur logiciel.
La RT 2005 apporte un coefficient de pondération des consommations énergétiques du bâtiment qui tient compte des zones climatiques en France et de l'altitude

Zones climatiques de la réglementation thermique de 2005 et de 2012.
La France est divisée en plusieurs zones climatiques qui correspondent des coefficients de rigueur climatique, qui pour la RT 2005 varient de 0,8 proche de la Méditerranée à 1,3 au nord de la France.
S'y ajoute un coefficient d'altitude, qui vaut 0,1 si l'altitude du bâtiment est comprise entre 400 et 800 mètres et 0,2 à plus de 800 mètres. Le calcul de la limite de consommation est alors : 50 × (coefficient de rigueur climatique + coefficient d’altitude). Il permet également d'attribuer l'étiquette (A à G).
RT 2012 ( 01/01/2013 --> 01/01/2022)
La RT 2012, définie à la suite du Grenelle de l'environnement, devient la référence. Elle vise à diviser par trois la consommation énergétique des bâtiments neufs, en s'alignant sur le label BBC 2005, soit une consommation maximale de 50 kWhep/(m2.an) (ep = énergie primaire). Ces 50 kWh sont à moduler en fonction de la zone géographique, de l'altitude, de la surface habitable... Ils concernent les cinq usages : chauffage, rafraîchissement, eau chaude sanitaire, ventilation et les auxiliaires.
Elle impose aussi d’autres contraintes :
-
la perméabilité à l’air des habitations neuves est limitée et contrôlée par mesure en fin de travaux. Cela définit l'étanchéité du bâtiment. Il doit perdre moins de 0,6 m3/h.m2 (maison individuelle) ou moins de 1 m3 (logement collectif) en une heure pour une surface de déperdition de 1 m2 (plancher bas exclu), exprimés à ±4 Pa de pression relative. Ce test consiste à mettre le logement en surpression et/ou dépression et mesurer les fuites grâce à une « fausse porte », c'est-à-dire un ventilateur piloté par ordinateur. Pour cela, toutes les bouches d’aération sont fermées ainsi que toutes les autres aérations prévues (portes, fenêtres, etc.) ;
-
en résidentiel, la surface de baie doit être égale au minimum à un sixième de la surface habitable ;
-
une maison individuelle doit utiliser de l'énergie renouvelable ou une solution alternative relativement écologique.
Les objectifs de la RT 2012 sont de :
-
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;
-
encourager le développement de nouvelles techniques ;
-
contribuer à l'indépendance énergétique nationale.
Dans le but de répondre à l'objectif des 20 % d'énergie renouvelable d'ici 2020, ainsi que de diminuer la production de gaz à effet de serre, la RT 2012 impose l'utilisation d'au moins une énergie dite renouvelable pour la construction de la maison particulière. Il peut s'agir :
-
du raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par des énergies renouvelables,
-
de capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire,
-
de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité,
-
de l'utilisation de pompes à chaleur en chauffage ou eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamique),
-
de chaudière ou poêle à bois,
-
de chaudière à micro-cogénération.
RE 2020 (depuis le 01/01/2022)
La RE 2020 introduit une innovation majeure : elle ne contrôle plus seulement la consommation énergétique des bâtiments neufs, mais aussi leur bilan carbone, en incluant l'analyse du cycle de vie des matériaux et équipements employés. Les enjeux de ce changement d'optique sont considérables, ce qui suscite d'intenses polémiques. En particulier, alors que la RT 2012 favorisait le gaz, la RE 2020 favorisera l'électricité afin de réduire les émissions de CO2 dues aux chaudières au fioul ou au gaz. Le Royaume-Uni a fait un choix plus clair en interdisant le gaz dans les bâtiments neufs à partir de 2025.
La RE 2020 entraîne la disparition progressive des logements neufs chauffés au gaz naturel, un mouvement déjà engagé en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni qui ont adopté des réglementations similaires. En effet, elle impose aux bâtiments neufs des seuils de consommation énergétique et d'émission de gaz à effet de serre à partir de l'été 2021 ; le seuil d'émission maximum autorisé est fixé dès 2021 à 4 kg de CO2 par an et par mètre carré pour les maisons, ce qui exclut de facto le gaz naturel ; pour les appartements, ce seuil est de 14 kg/m2, ce qui laisse encore la possibilité d'installer du chauffage au gaz, à condition que l'isolation des logements soit très performante, mais il passera à 6 kg/m2 en 2024, excluant de fait le chauffage exclusivement au gaz, mais permettant des solutions hybrides. Ce délai permettra de développer les alternatives : réseaux de chaleur, chaufferie biomasse, pompe à chaleur collective, solaire thermique. Afin de limiter les risques de voir se multiplier les convecteurs électriques, la réglementation introduit un seuil maximal de consommation d'énergie primaire non renouvelable.